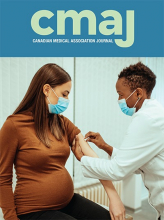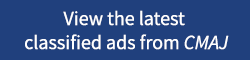L’évaluation initiale des convulsions chez une patiente en période post-partum devrait inclure un vaste diagnostic différentiel comprenant des causes liées à la grossesse et autres causes.
La céphalée post-ponction durale et ses séquelles devraient faire partie du diagnostic différentiel des convulsions, même en l’absence d’une ponction durale médicalement reconnue.
Les convulsions chez une patiente présentant une céphalée post-ponction durale sont rares; il est recommandé de consulter rapidement en anesthésiologie pour déterminer la pertinence d’un colmatage sanguin épidural.
Une femme de 31 ans s’est présentée au service d’urgence 7 jours après son accouchement après avoir subi 4 épisodes de crises tonico-cloniques généralisées. Sa plus récente grossesse (troisième enfant) s’est déroulée sans complications et s’est conclue par un accouchement spontané par voie vaginale avec analgésie épidurale. La mise en place de l’épidurale a nécessité 2 tentatives; la technique de perte de résistance (à une solution physiologique salée) a été appliquée avec succès, le cathéter servant à l’épidurale a été introduit facilement et aucune aspiration du liquide céphalorachidien n’a été observée. L’épidurale a entraîné une analgésie asymétrique sans blocage moteur associé, et aucune préoccupation concernant la ponction durale n’a été consignée. La patiente avait déjà eu 2 grossesses sans complications, pour lesquelles l’accouchement avait eu lieu sous anesthésie épidurale.
Vingt-quatre heures après l’arrêt de l’épidurale, la patiente a commencé à se plaindre d’une céphalée accompagnée d’étourdissements, de nausées et de vomissements, qui s’atténuait lorsqu’elle se couchait sur le dos. Les caractéristiques de la céphalée concordaient avec une hypotension intracrânienne et une céphalée post-ponction durale (CPPD). La patiente a d’abord tenté de traiter sa céphalée avec de l’acétaminophène et de la caféine et en s’hydratant par voie orale. Ses symptômes se sont toutefois aggravés progressivement au cours des 6 jours suivants, et 7 jours après son accouchement, elle a eu des convulsions chez elle et durant le transport vers le service d’urgence.
Au service d’urgence, la patiente était au bord des larmes, somnolente et quelque peu confuse, ce qui correspondait à un état post-ictal. Sa pression artérielle était de 109/72 mm Hg et son pouls était de 93 battements/min. Son indice de masse corporelle était de 26. Son examen neurologique (nerfs crâniens, force, réflexes et sens) était normal. Sa nuque était souple et ne présentait aucun signe d’irritation méningée. L’examen de la colonne vertébrale et du point d’introduction de l’épidurale n’a révélé ni changement cutané, ni sensibilité, ni signes d’infection. La patiente avait des antécédents d’hypothyroïdie légère et de reflux gastro-œsophagien pathologique, mais ne présentait aucun antécédent de trouble hypertensif de la grossesse.
Nous avons administré à la patiente du sulfate de magnésium comme prophylaxie anticonvulsive (4 g par voie intraveineuse sur 15 minutes, suivis d’une perfusion de 1 g/h pendant les 24 heures suivantes). Nous avons envisagé de nombreux diagnostics différentiels, notamment les suivants: éclampsie, nouveau trouble convulsif primaire, hémorragie intracrânienne, infection du système nerveux central, masse intracrânienne et manifestation tardive d’une complication liée à l’épidurale (encadré 1). La formule sanguine complète, les taux de créatinine sérique, d’aspartate aminotransférase et d’alanine aminotransférase, le rapport international normalisé (RIN) et le temps partiel de thromboplastine (TPT) étaient normaux, et l’analyse d’urine n’a révélé aucune protéinurie; une éclampsie nous semblait donc improbable. Les résultats d’une tomodensitométrie (TDM) de la tête de la patiente sans agent de contraste indiquaient la possibilité d’une hypotension intracrânienne secondaire à une ponction lombaire, notamment un hygroma sousdural gauche (figure 1). Un tomodensitogramme de la tête avec agent de contraste n’a révélé aucun signe de thrombose d’un sinus veineux de la dure-mère. Enfin, les résultats d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) concordaient avec une hypotension intracrânienne et montraient un hygroma sous-dural gauche (figure 2).
Encadré 1: Diagnostics différentiels des convulsions post-partum
Obstétriques
Éclampsie post-partum
Syndrome de Sheehan
Embolie amniotique
Anesthésiologiques
Céphalée post-ponction durale
Embolie gazeuse
Neurologiques
Trouble convulsif primaire
Lésion structurelle
Accident vasculaire cérébral
Hémorragie intracrânienne
Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible
Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible
Fuite spontanée de liquide céphalorachidien
Métaboliques
Syndrome de sevrage (p. ex., sevrage d’alcool)
Anomalies électrolytiques
Urémie
Hypoglycémie
Anomalies thyroïdiennes
Infectieux
Méningite ou encéphalite
Psychiatriques
Crise pseudo-convulsive
Autres
Porphyrie
Images tomodensitométriques sans agent de contraste du cerveau d’une femme de 31 ans présentant des convulsions post-partum. (A) Vue sagittale montrant un effacement de la citerne prépontique (flèche pointant vers la droite) ainsi qu’un léger affaissement du tronc cérébral. Les amygdales cérébelleuses sont normales; il n’y a aucun engagement ou ectopie en dessous du trou occipital (flèche pointant vers la gauche). Vues axiales montrant un effacement des citernes basales (B) ainsi qu’un petit hygroma sous-dural gauche (C) (flèches) avec effet de masse local léger, entraînant un effacement des sillons.
Clichés d’imagerie par résonance magnétique pondérés en T2 du cerveau d’une femme de 31 ans présentant des convulsions post-partum. (A) Vue sagittale médiane ne montrant aucune hypertrophie de l’hypophyse. (B) Vues axiales montrant un rehaussement homogène diffus et linéaire de la dure-mère le long des convexités cérébrales (pointes de flèches) — un signe caractéristique de l’hypotension intracrânienne — et (C) un hygroma sous-dural hyperintense en T2 (flèches).
Nous avons hospitalisé la patiente au service de médecine interne et consulté en obstétrique, en anesthésie, en neurologie et en neurochirurgie; dans cette dernière spécialité, on était d’avis qu’aucune intervention chirurgicale n’était nécessaire. Étant donné les symptômes convaincants de CPPD et les résultats de l’imagerie indiquant une hypotension intracrânienne, l’anesthésiste a effectué un colmatage sanguin épidural le lendemain de l’admission. Après avoir reçu une injection de 28 mL de sang dans l’espace épidural, la patiente a rapporté une sensation de pression dans le bas du dos et un soulagement immédiat de sa céphalée. Avant son congé, nous lui avons prescrit un électroencéphalogramme (EEG) pour déterminer si elle était atteinte d’un trouble convulsif primaire; aucune anomalie épileptiforme n’a été observée. La patiente n’a pas eu d’autres convulsions et a pu retourner chez elle 5 jours après son hospitalisation. Comme nous avions relevé une cause réversible pour ses convulsions, en neurologie, on a décidé de ne pas prescrire de médicaments antiépileptiques. Deux mois plus tard, les résultats d’une IRM de suivi étaient normaux, et l’hématome sous-dural s’était résorbé.
Discussion
Les convulsions chez une patiente en période post-partum peuvent poser des difficultés d’ordre diagnostique, puisque les médecins doivent envisager à la fois les causes liées à la grossesse et les autres causes (encadré 1). On constate avec le présent cas que l’hypotension intracrânienne découlant d’une ponction durale, bien que peu courante, devrait être considérée comme une cause de convulsions après une analgésie épidurale. La combinaison de céphalées et de convulsions en période postpartum devrait faire soupçonner une éclampsie post-partum, même en l’absence d’autres symptômes courants comme les altérations visuelles, l’œdème et la douleur épigastrique1. Des cas d’éclampsie normotensive ont été signalés, mais sont rares2. Une autre cause potentielle de convulsions et de céphalées postpartum est le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, qui se caractérise par une vasoconstriction multifocale réversible des artères cérébrales de gros et de moyen calibres. Les céphalées propres à ce syndrome possèdent des caractéristiques semblables à celles de l’éclampsie; elles sont intenses et diffuses, et génèrent une douleur qui frappe comme un « coup de tonnerre »3. Ces symptômes s’inscrivent en contraste avec ceux de la CPPD, qui varient en intensité selon la position (la douleur est pire en position debout et diminue en position couchée sur le dos) et s’accompagnent souvent de photophobie, de nausées ou de vomissements4.
Les patientes enceintes et en période post-partum présentant des convulsions devraient passer les examens initiaux suivants: formule sanguine complète, analyse des taux d’enzymes hépatiques, de créatinine, de fibrinogène, d’électrolytes (calcium et magnésium), TPT, RIN, analyse d’urine ou rapport albumine–créatinine et mesure de la glycémie. Ces examens peuvent aider à détecter la prééclampsie et le syndrome HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets [hémolyse, élévation des enzymes hépatiques et numération plaquettaire basse]). Si les résultats de ces examens initiaux se révèlent normaux, il est moins probable que les convulsions soient induites par une éclampsie, surtout si la patiente est normotendue. À ce stade, il faut envisager d’autres causes et demander l’avis de spécialistes au besoin.
La première imagerie du cerveau consiste généralement en une TDM avec agent de contraste ou une IRM, 2 examens pouvant révéler la présence d’une pathologie intracrânienne comme une hémorragie intracrânienne, un infarcissement ou des lésions structurelles. On diagnostique l’hypotension intracrânienne par l’observation de changements caractéristiques à l’IRM (présence d’hématomes sous-duraux, rehaussement pachyméningé ou affaissement cérébral) et la présence d’au moins 1 des caractéristiques suivantes: pression d’ouverture inférieure à 60 mm H2O, diverticule méningé de la colonne vertébrale à l’IRM ou amélioration des symptômes après le colmatage sanguin épidural5. Une augmentation de la taille de l’hypophyse à l’IRM a été rapportée chez des patientes atteintes d’une hypotension intracrânienne symptomatique; l’observation d’une taille supérieure à la normale a une sensibilité de 63 % et une spécificité de 97 %6. Fait intéressant, la taille de l’hypophyse chez notre patiente n’avait pas augmenté (figure 2A). L’hypotension intracrânienne cause un affaissement cérébral et une tension sur les veines entre la duremère et l’arachnoïde. Si ces vaisseaux rompent, un hygroma sous-dural peut se former, comme chez notre patiente. Si la TDM et l’IRM de la tête ne montrent aucune cause des convulsions, on devrait envisager une angiographie par résonance magnétique pour déterminer s’il y a vasoconstriction des artères cérébrales, une caractéristique du syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible3. Un EEG peut permettre de détecter un trouble convulsif primaire; en effet, les patientes atteintes d’épilepsie sont sujettes aux convulsions post-partum en raison d’un manque de sommeil.
Si la patiente est en train de convulser, le traitement devrait viser à mettre fin aux convulsions; le sulfate de magnésium est l’agent de première intention si l’éclampsie est la cause présumée. Le sulfate de magnésium peut être administré en perfusion comme prophylaxie subséquente. Les réflexes et la fréquence respiratoire de la patiente devraient faire l’objet d’une surveillance étroite étant donné le risque d’intoxication et de dépression respiratoire associé au magnésium, des complications qui avaient touché près de 1 % des patientes ayant reçu du sulfate de magnésium et 0,5 % de celles ayant reçu un placebo dans le cadre d’une revue7. Toutefois, une réduction de 58 % du risque relatif de convulsions éclamptiques chez les patientes atteintes de prééclampsie traitées avec du sulfate de magnésium l’emporte généralement sur ce risque (nombre de sujets à traiter pour prévenir une crise convulsive: 100)7.
Une fois qu’il a été déterminé que la patiente a des convulsions associées à une CPPD, un colmatage sanguin épidural devrait être envisagé. Cette intervention nécessite l’injection d’environ 20 mL de sang autologue (obtenu par prélèvement de sang veineux) dans l’espace épidural. Le taux de succès est variable; un soulagement complet ou partiel a été rapporté dans 50 %–80 % des cas8. Il semble qu’une injection de plus de 20 mL ne fournit pas toujours un meilleur soulagement; cependant, la norme de soins dans certains hôpitaux consiste à injecter du sang jusqu’à ce que la patiente éprouve une sensation de lourdeur ou d’inconfort dans le bas du dos, ce qui peut se produire après l’injection d’un peu moins ou un peu plus de 20 mL de sang8. L’intervention comporte un risque léger de saignements et d’infection. Environ 50 % des patientes souffrent de dorsalgie 24 heures après l’intervention, mais aucune donnée n’indique une augmentation de la fréquence de la dorsalgie chronique9. Deux théories principales ont été avancées pour expliquer comment fonctionne un colmatage sanguin épidural. Selon la théorie du bouchon, le sang introduit dans l’espace épidural formerait un caillot fibrineux qui referme l’ouverture durale pour empêcher que le liquide céphalorachidien (LCR) continue de s’échapper9. Cette théorie n’arrive toutefois pas à expliquer pourquoi les patientes ressentent un soulagement immédiat après l’intervention. D’après la théorie du rétablissement de la pression dans l’espace épidural, le sang injecté dans cet espace augmenterait la pression dans l’espace sous-arachnoïdien en compressant instantanément la dure-mère, ce qui pousse le LCR à remonter et rétablit immédiatement le volume et la pression du LCR intracrânien9. Le mécanisme réel est probablement une combinaison des 2 théories.
On estime que le taux d’incidence de la CPPD après une rachianesthésie serait de 6 %–36 %10. Sa prévalence après la pose d’un cathéter épidural sans ponction durale n’a cependant pas été décrite, malgré le recours répandu à l’analgésie épidurale10. Son taux d’incidence chez des patientes ayant subi une ponction durale aux fins d’anesthésie épidurale se situerait entre 76 % et 85 %11. Fait important, les patientes en période post-partum présentent un risque élevé de CPPD puisque le genre féminin, la jeunesse et la grossesse sont tous des facteurs de risque indépendants associés au développement de cette affection10. Les patientes ayant des antécédents de CPPD sont plus susceptibles de rencontrer les problèmes suivants: dépression post-partum, trouble de stress post-traumatique, céphalées et maux de dos chroniques et diminution de l’allaitement maternel 6 mois après l’épidurale12.
Les mécanismes sous-jacents de la CPPD sont mal connus. On pense que la CPPD serait causée par une traction des structures intracrâniennes liées à la douleur découlant de la diminution du volume de LCR et par une vasodilatation compensatoire subséquente des vaisseaux intracrâniens visant à maintenir le volume intracrânien4. Comparativement à la rachianesthésie, une ponction involontaire de la dure-mère pendant la mise en place de l’épidurale entraîne une plus grande diminution du volume de LCR, car les aiguilles utilisées sont de plus gros calibre. Le mécanisme à l’origine des convulsions après une CPPD est tout aussi mal connu. Cependant, au moyen de l’artériographie, Shearer et ses collègues13 ont montré qu’un mécanisme possible impliquerait des modifications du débit sanguin régional dues à un vasospasme diffus. Ce vasospasme peut être secondaire à un déplacement anatomique du cerveau associé à une diminution du volume de LCR.
Les convulsions d’apparition tardive après une CPPD sont une complication rare. Étant donné le large éventail de diagnostics différentiels et les complications potentielles chez une patiente en période post-partum présentant des convulsions, l’examen diagnostique devrait être exhaustif et effectué au moment opportun, et la prise en charge devrait être réalisée par une équipe multidisciplinaire.
Footnotes
Intérêts concurrents: Aucun déclaré.
Cet article a été révisé par des pairs.
Les auteurs ont obtenu le consentement de la patiente.
Collaborateurs: Tous les auteurs ont contribué à l’élaboration et à la conception du travail. Ejaz Causer et Isabelle Birchall ont rédigé le manuscrit. Tous les auteurs ont révisé de façon critique le contenu intellectuel important du manuscrit; ils ont donné leur approbation finale pour la version destinée à être publiée et assument l’entière responsabilité de tous les aspects du travail. Ejaz Causer et Isabelle Birchall sont les auteurs principaux.
This is an Open Access article distributed in accordance with the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND 4.0) licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the original publication is properly cited, the use is noncommercial (i.e., research or educational use), and no modifications or adaptations are made. See: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/